.jpg)
Juritravail, votre service juridique en ligne pour rendre le droit plus simple : droit du travail, droit des affaires, droit de la famille…
Obtenez en un clic toutes vos informations, modèles de lettres ou contrats et bénéficiez de notre assistance juridique
Juritravail : votre partenaire juridique
+ de 500 dossiers thématiques
Professionnels, CSE, particuliers, évitez de longues recherches juridiques ! Gagnez du temps et obtenez en quelques clics toutes les informations et procédures dont vous avez besoin.

+ de 1000 modèles de lettres et contrats
Téléchargez nos modèles de lettres, contrats, courriers juridiques, traitant de toutes les problématiques. Simples, personnalisables et certifiés.

+ de 400 documents indispensables
Accédez à notre base, toujours à jour, de conventions collectives certifiées par Legifrance et d’affichages obligatoires actualisés régulièrement par nos juristes.

À propos
La mission de Juritravail
Vous simplifier le droit au quotidien !





Besoin d'un accompagnement juridique pour gérer votre entreprise ? Découvrez nos abonnements !
Les abonnements Juritravail sont LA solution pour vous faire gagner du temps et vous libérer l'esprit des contraintes réglementaires.
Profitez d’une assistance juridique illimitée pour répondre à toutes vos questions professionnelles et personnelles ! Nos experts dédiés (juristes et avocats) sont à votre disposition pour vous accompagner dans tous les aspects de votre vie d’entrepreneurs, rh, dirigeants d'entreprises...

Des experts pour vous informer
Des dossiers pour vous éclairer dans vos démarches juridiques
Un accès illimité à nos modèles de documents (lettres et contrats)
Une mise en relation privilégiée avec nos juristes et avocats
Ils nous font confiance





Une question sur la gestion de votre entreprise ?
Posez votre question gratuitement à nos juristes dès aujourd'hui. Ils vous répondent en moins de 24h.
- Le Forum Juritravail : Vous pouvez y poser toutes vos questions dans tous les domaines de droits (droit du travail, droit de la famille - divorce, droit de l'immobilier ou tout autre droit) et obtenir gratuitement des réponses.
- Nos avocats partenaires : Choisissez parmi plus de 100 avocats compétents dans tous les domaines de droit (travail, famille, immobilier, fiscal, consommation...) pour obtenir un conseil juridique par téléphone. (01 75 75 42 33 - Service payant)
Accédez à tous nos documents juridiques
Chaque modèle de lettres et contrats, certifiés par nos juristes, vous évitent les erreurs administratives et juridiques. Gain de temps assuré, il vous suffit de les télécharger et de les compléter avec vos informations.
Modèle de présentation simplifiée des comptes annuels pour le CSE
Mis à jour le 20/01/2025
DécouvrirChaque dossier, rédigé par nos juristes, comprend les réponses aux questions les plus posées, des documents RH, des modèles de lettres et contrats qui vous résument l'essentiel des lois.
Chaque entreprise doit mettre à la disposition de ses salariés la convention collective de l'entreprise ainsi que des affichages obligatoires (règlement intérieur, affichage tout-en 1, consignes de sécurité...) pour être en conformité avec la loi. Téléchargez dès maintenant votre convention collective à jour des derniers accords et commandez vos affichages obligatoires en un clic.
Document unique d'évaluation des risques professionnels - obligatoire...
Mis à jour le 11/12/2025
DécouvrirDécouvrez le droit autrement : Regardez nos juristes experts en vidéo !
Le droit n’a jamais été aussi facile à comprendre. Grâce aux vidéos de nos juristes : webconférences, interviews ou sujets juridiques traités en moins de trois minutes... tout devient clair et accessible. Nos experts simplifient ce qui peut sembler complexe, sans jargon inutile. Que ce soit pour une question pratique ou un point précis de la législation, tout est à portée de clic. Lancez une vidéo et obtenez votre réponse immédiatement.
Licenciement économique : maîtrisez la procédure, du licenciement individuel au PSE
Harcèlement et burn-out : comment prévenir et gérer les crises en entreprise
Mise à pied, avertissement, licenciement : maîtriser le risque disciplinaire
Anticipez les élections du CSE 2026
Les entretiens annuels 2026 : Tips pour les mener efficacement
Temps de travail et forfait jours : les pièges à éviter
Votre Convention Collective décryptée et résumée en toute simplicité
Nous savons que l’application de votre convention collective peut être complexe et générer de nombreuses questions juridiques. C’est pourquoi nos juristes ont élaboré une synthèse claire et complète pour vous simplifier la tâche.
.jpg)

Synthèse convention collective Syntec
Télécharger.jpg)
Synthèse convention collective des hôtels, cafés, restaurants
Télécharger
Synthèse convention collective BAD
Télécharger
Synthèse convention collective des transports routiers
Télécharger
Synthèse convention collective Bâtiment Ouvriers
Télécharger
Synthèse convention collective de détail de gros
Télécharger
Synthèse convention collective commerces de gros
Télécharger
Convention collective des entreprises de propreté et services associés
Télécharger
Convention collective des entreprises de services à la personne
Télécharger
Convention collective Prévention et sécurité
Télécharger
Convention collective des organismes de formation
Télécharger
Convention collective 66
TéléchargerLes dernières actualités juridiques

Par Alice Lachaise le 11/12/2025 • 28054 vues
Le plafond de la Sécurité sociale (PSS) est en principe revalorisé chaque année, en fonction de l’évolution des salaires. Le plafond a augmenté de 1,6% le 1er janvier 2025, et il devrait...
Par Lorène Bourgain le 11/12/2025 • 10575 vues
Lorsqu'il s'agit de la gestion des comptes et de la conformité financière d'une entreprise, il...
Par Caroline Audenaert Filliol le 11/12/2025 • 1427287 vues
Instituée en 2004, la journée de solidarité (originellement, le lundi de Pentecôte)...
Par Martial Moukagni-Nziengui le 11/12/2025 • 13971 vues
L'extrait K ou Kbis est un document très important pour toute entreprise dont l'activité est...
Quoi de neuf chez Juritravail cette semaine :
-

Nos dossiers juridiques
-

Nos webconférences gratuites
-

Nos tops actus
Chaque jour, nos juristes vous simplifient le droit avec des dossiers clairs, concrets et à jour pour gérer votre entreprise en toute sérénité.
Découvrir nos dossiers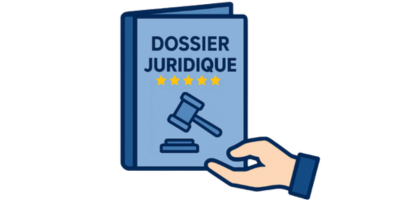
Embauche d'un salarié étranger hors UE : tout savoir
Recruter un salarié étranger peut être une vraie opportunité pour votre entreprise… mais c’est aussi un cadre juridique strict à respecter. Quels titres permettent de travailler ? Quand faut-il une autorisation ? Quelles démarches suivre ? On vous explique tout dans notre dossier !
Découvrir le dossierProfessionnels, participez gratuitement à nos webconférences. Retrouvez la prochaine webconférence de Juritravail et les derniers replay.
Voir toutes nos webconférences.png)
Mise à pied, avertissement, licenciement : maîtriser le risque disciplinaire
Un avertissement contesté, une mise à pied jugée disproportionnée, un licenciement disciplinaire mal formalisé… Ces erreurs de procédure coûtent cher aux entreprises et affaiblissent l’autorité managériale. Chaque année, des centaines d’employeurs voient leurs sanctions annulées ou requalifiées aux prud’hommes, faute d’avoir respecté le cadre légal.
Je réserve ma placeProfessionnels, ne manquez rien de l’actualité juridique ! Découvrez nos derniers articles rédigés par nos juristes pour rester à jour.
Voir toute l'actualité juridique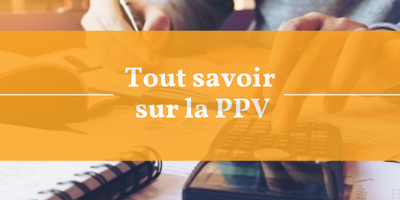
PPV 2025 (ex-prime Macron) : montants, conditions et versement
Depuis le 1er janvier 2025, certaines entreprises de 11 à 49 salariés doivent également mettre en place un dispositif de partage de la valeur (expérimentation). De plus, la PPV a été intégré dans l'assiette de la réduction générale de cotisations patronales, ce qui en diminue son régime de faveur depuis le 1er janvier 2025. Explications.
Lire la suite
Besoin de consulter un avocat ?
Selon votre besoin, Juritravail vous propose deux services :
- consultez un avocat disponible immédiatement par téléphone,
- ou bien recevez des devis d'avocats compétents près de chez vous afin de rencontrer celui qui vous convient.
Appelez notre équipe au 01 75 75 42 33 pour vous faire accompagner (prix d'un appel local).









Tout est très bien détaillé et présenté. Sauf que je recherche une réponse concernant : Après une rupture de contrat de travail de ma part en intérim, je suis allé voir mon médecin traitant quelques jours après parce que je me sentais...