Le salarié jouit de droits et libertés fondamentaux garantis par la législation du travail dont seront ici examinés les principaux.
Protection contre le licenciement discriminatoire
Aux termes des dispositions de l’article L. 1132-1 du Code du travail, est interdit tout licenciement d'un salarié « en raison de son origine, de son sexe, de ses m½urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme... ».
L’article 1132-3 accroît cette protection en disposant qu’aucun salarié ne peut être licencié « pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés ».
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que si l'article L. 1132-1 prohibe tout licenciement fondé sur la situation de famille du salarié, ce texte « ne distingue pas selon le lien matrimonial ou le lien familial. Il s'ensuit qu'une cour d'appel décide exactement que ce texte interdit le licenciement d'un salarié reposant sur le lien de filiation l'unissant à un autre salarié de l’entreprise (Cass. soc. 1er juin 1999, Bull. civ. V, n° 249).
En revanche, la Haute Juridiction a estimé que les dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque le licenciement est fondé sur un trouble objectif résultant du comportement du salarié (Cass. soc. 14 novembre 2000, Bull. civ. V, n° 369). En l'espèce, l'employeur avait licencié une salariée au motif que le comportement de son conjoint, étranger à l'entreprise, entraînait des conséquences dommageables pour cette dernière.
À d’autres points de vue, « s'il est exact que l'employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n'entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l'employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché, dès l'instant que celle-ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre public » (Cass. soc. 24 mars 1998, Bull. civ. V, n° 171). Dans ce contentieux, un salarié avait été engagé en qualité de boucher. Postérieurement à son détachement au rayon boucherie, celui-ci s’est aperçu qu'il était en contact avec de la viande de porc et a jugé cette situation incompatible avec son orientation religieuse. Il a en conséquence sollicité une affectation dans un autre service. Face au refus exprimé par son employeur, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a également jugé que lorsqu'un salarié tient publiquement des propos offensants et injurieux à l'encontre de plusieurs chefs d'États, son licenciement pour faute grave motivé par une méconnaissance de son obligation de réserve se trouve justifié. Le
salarié ne saurait prétendre, en pareil cas, avoir été licencié en raison de ses opinions politiques (Cass. soc. 6 octobre 1993, n° 91-45.053).
S’agissant du régime probatoire du motif discriminatoire du licenciement, il incombe au salarié, conformément aux dispositions de l’article 1134-1, non plus comme auparavant « d’établir des faits », mais de simplement présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
Si la charge de la preuve pèse pour l'essentiel sur l’employeur, la Cour de cassation considère néanmoins que la simple allégation par le salarié de ce que son licenciement aurait pour cause son activité syndicale ne saurait justifier son annulation sur le fondement de l'article L. 1132-1 du Code du travail (Cass. soc. 3 avril 2002, n° 00-42.583) ;
Protection contre le travail dissimulé
(Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).
Inévitablement, la question de l'articulation entre la répression administrative - souhaitée car estimée plus efficace - et la répression pénale - omniprésente dans la lutte engagée contre le travail illégal - se pose au risque de rendre particulièrement complexe la compréhension de la portée de la sanction administrative à l’égard de la sanction pénale.
C'est là une question que la loi « Macron » a volontairement délaissée pour privilégier l'efficacité de la sanction administrative sur la sanction pénale. En témoignent les modifications apportées à la mesure de fermeture qui peut, à la fois, être administrative et judiciaire. Ainsi, antérieurement à la loi « Macron », l'article L. 8272-2 du code du travail, issu de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, avait conféré à l'autorité administrative le pouvoir d'ordonner la fermeture provisoire de l'établissement ayant servi à commettre l'une des infractions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, à savoir les délits de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d‘½uvre et d'emploi d'étranger sans titre de travail. Déjà modifié par la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, l'article L. 8272-2 du code du travail a, depuis lors, fait l’objet de trois modifications successives : d’abord par la loi du 6 août 2015, ensuite par celle du 8 août 2016, et enfin par celle du 5 septembre 2018 ;
Il résulte désormais dudit article que la mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale.
Protection contre le harcèlement moral et sexuel
La protection contre le harcèlement moral est inscrite aux articles L. 1152-1 et suivants du Code du travail. Aux termes de l'article L. 1152-2, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Quant à l’article L. 1152-3, il précise que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait est nulle.
Des dispositions similaires sont prévues en matière de harcèlement sexuel par l'article L. 1153-1 du Code du travail. En application de ce texte, aucun salarié ne peut être licencié « pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ». En outre, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné de ces agissements ou pour les avoir relatés.
L'article L. 1153-1 a fait l’objet de plusieurs modifications dont la dernière en date par la loi n°2021-1018 du 2 août 2021.
La rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, a élargi la définition du harcèlement sexuel, mettant fin à la désignation restrictive des personnes susceptibles de s'y livrer. Dans son ancienne version, datant de la loi du 2 novembre 1992, cet article prévoyait qu'aucun « salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ». En d'autres termes, le harcèlement sexuel reposait sur un abus d'autorité. Il supposait qu'une personne utilise sa position hiérarchique pour obtenir des faveurs sexuelles, en procédant par exemple à un chantage à l'emploi ou à la promotion (M. MINÉ et F. SARAMITO, Le harcèlement sexuel, Dr. ouvrier 1997.48)
Cette condition ayant disparu, un tel comportement peut être caractérisé entre deux collègues de travail de même rang hiérarchique, voire même entre un subalterne au comportement trop pressant et son supérieur hiérarchique.
Pour faciliter la preuve de l'existence d'un harcèlement, qu'il soit de nature morale ou sexuelle, le législateur avait initialement prévu, comme en matière de discrimination, que le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Ce régime probatoire, particulièrement favorable au salarié, est issu de la directive communautaire n° 97/80 du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve en matière de discrimination sexuelle. Si le législateur français est ainsi en conformité avec le droit communautaire, le juge national chargé d'appliquer ces dispositions doit prendre en compte les réserves d'interprétation émises en la matière par le Conseil constitutionnel. En effet, dans sa décision du 12 janvier 2002, la Haute juridiction a estimé que « les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse instaurées par les dispositions critiquées ne sauraient dispenser celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle la décision prise à son égard [...] procéderait d'un harcèlement moral ou sexuel au travail ; qu'ainsi, la partie défenderesse sera mise en mesure de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et de prouver que sa décision est motivée, [...] par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;qu'en cas de doute, il appartiendra au juge, pour forger sa conviction, d'ordonner toutes mesures d'instruction utiles à la résolution du litige ; que, sous ces strictes réserves d'interprétation, les articles 158 et 169 ne méconnaissent pas le principe constitutionnel du respect des droits de la défense » (Cons. const. n° 2001-455 du 12 janvier 2002).
Souhaitant sans doute prendre en compte les réserves émises par le Conseil constitutionnel, le législateur a modifié la version originelle de l'article L. 1154-1. Ce texte impose désormais au salarié d'établir « des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ». Au-delà d'une formulation différente, il n'est pas certain que le nouveau texte se montre plus exigeant à l'égard du demandeur.
Protection du droit de grève
Droit à valeur constitutionnelle, l'exercice du droit de grève fait l'objet de toutes les attentions du législateur. L'article L. 2511-1 du Code du travail énonce en effet que « la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié. » Le troisième alinéa prévoit quant à lui que tout licenciement prononcé en violation de cette règle « est nul de plein droit. » En outre, l'article L. 1132-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié « en raison de l'exercice normal du droit de grève. »
En application de ces textes, « la nullité du licenciement d'un salarié gréviste n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève; elle s'étend à tout licenciement d'un salarié prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe et qui ne peut être qualifié de faute lourde » (Cass. Soc. 22 janvier1992, Bull. civ. V, n° 19).
En l'espèce, le salarié gréviste, employé en qualité de sapeur-pompier, avait été licencié pour faute grave au motif qu'il avait introduit dans l'entreprise dans laquelle il était détaché, un autre salarié de son employeur qui devait participer à une réunion de négociation avec la direction de la société.
Protection de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé
Le licenciement de certains salariés est soumis à une procédure particulière en raison du statut protecteur dont ils bénéficient. Cette protection concerne notamment les titulaires de mandats électifs dans l'entreprise (délégués du personnel, membres du CE et du CHSCT), les représentants des organisations syndicales dans l'entreprise (délégués syndicaux, représentants syndicaux au CE), les conseillers prud'homaux ainsi que les conseillers des salariés.
La violation de ce statut protecteur ou l'annulation de l'autorisation de licenciement entraîne la nullité du licenciement de l'intéressé. À titre d'exemple, l'annulation d'une candidature à une fonction représentative du personnel n'a pas d'effet sur le statut protecteur, la perte de la qualité de salarié protégé intervenant à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé. Il en résulte que le licenciement, intervenu sans autorisation administrative avant la décision d'annulation de la candidature, est prononcé en violation du statut protecteur et que le salarié a droit, outre la réparation du préjudice consécutif à celui-ci, à la réparation du préjudice né du licenciement nul (Ibid).
En revanche, n'est pas nul le licenciement d'un salarié dont l'autorisation administrative donnée au licenciement a été annulée au motif qu'il n'avait plus la qualité de salarié protégé quand cette autorisation a été accordée, ce dont il résultait que le licenciement n'avait pas à être soumis à autorisation (Cass. Soc. 10 décembre 1997, Bull. civ. V, n° 435).
L’apport de la loi MACRON à la réforme du délit d’entrave. De la loi dite « Macron », a résulté la réforme des délits d'entrave, réforme bien timide puisque les textes nouveaux se contentent de distinguer en deux alinéas l'atteinte, d'une part, à la désignation des représentants punie d'un emprisonnement identique tandis que la peine d'amende est doublée ; et l'atteinte, d'autre part, à l'exercice régulier des fonctions desdits représentants punie uniquement d'une peine d'amende dont le montant est doublé. La peine d’emprisonnement ayant été supprimée dans le cas de l’atteinte au fonctionnement, l’on peut redouter que cette suppression soit appréhendée comme une méconnaissance d’un des droits et libertés fondamentaux du salarié.
Protection de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1146-1 du Code du travail, « est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce dernier ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure de rétorsion prise par l'employeur à raison de l'action en justice » (Cass. soc. 28 novembre 2000, Bull. civ. V, n° 395).
Protection de l'intégrité physique du salarié
Les dispositions relatives à la protection de l'intégrité physique du salarié intéressent le salarié victime d'un accident ou d'une maladie de droit commun, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et la salariée en état de grossesse.
Protection du salarié victime d'un accident ou d'une maladie de droit commun.
Sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, l'article L. 1132-1 interdit tout licenciement d'un salarié « en raison de son état de santé ou de son handicap ».
En application de ce principe, en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité? de deuxième catégorie est nul. Par ailleurs, « s'il est exact que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut néanmoins envisager de rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste de travail en raison de l'impossibilité de le reclasser que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail qui prévoit que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 1132-1 du Code du travail » (Cass. soc. 16 février 1999, Bull. civ.V, n° 76).
En outre, il appartient à l'employeur, lorsque l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 4624-31 du code du travail, de faire subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen médical prévu par ce texte. Le licenciement prononcé en contravention de ces dispositions est nul » (Cass. soc. 16 juillet 1998, Bull. civ. V, n° 393).
Il importe enfin de rappeler que les dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail n'interdisent pas à l'employeur de procéder au licenciement du salarié, non en raison de son état de santé, mais en raison du trouble que son absence prolongée ou ses absences répétées apportent au bon fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.
Protection du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Comme son nom l'indique, l'accident du travail ou la maladie professionnelle trouve son origine dans l'exercice d'une activité professionnelle. Par conséquent, il est normal que l'entreprise en assume les conséquences. À ce titre, en application des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail, l'exécution du contrat de travail du salarié victime d'un accident ou d'une maladie de cette nature est suspendue pendant toute la durée de l'arrêt de travail ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre le salarié.
Au cours de ces périodes de suspension, l'employeur ne peut, résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie « soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat » (L 1226-9 du code du travail).
Les dispositions de l’article 1226-13 du code du travail énonce que « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-18 est nulle ».
La suspension de l'exécution du contrat de travail dure jusqu'à la visite médicale de reprise. Elle ne peut prendre fin tant que cette visite obligatoire n'a pas été effectuée, peu important que l'arrêt de travail médicalement prescrit soit arrivé à son terme ou que la Sécurité sociale ait cessé de prendre en charge le salarié au titre des accidents du travail (Cass. soc. 15 février 1995, n° 91-40.923, Mme Lacombe c/ Ducros et fils).
Par conséquent, si, à la suite d'un accident du travail, le salarié reprend son activité sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 4624



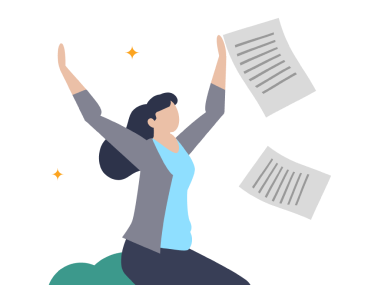




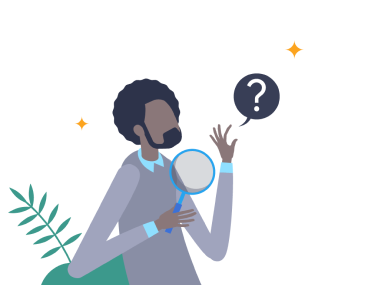

Très réactif, pro et fiable. Merci